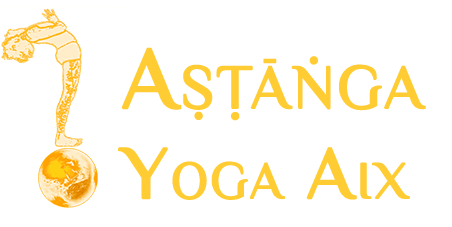Yama dans les Yoga Sutra
Le yoga est considéré comme un art, une science et une philosophie.
Patañjali, à qui l’on attribue les Yoga Sūtra, qu’il soit un homme, une légende ou un collectif, n’a pas inventé un Yoga. Il a rassemblé, clarifié et ordonné un ensemble de connaissances et de pratiques déjà vivantes dans la culture yogique ancienne, tout en intégrant l’actualité du Yoga de son époque.
La tradition indienne a reconnu ce texte comme l’un des six systèmes orthodoxes, Darśana, un point de vue, c’est-à-dire qui n’exclut pas les autres textes et systèmes, mais qui fait certains choix. Chaque Darśana éclaire la réalité sous un certain angle, sans prétendre détenir l’unique vérité.
C’est donc un point de vue qui étudie la nature humaine et ouvre des pistes d’explorations aux questions existentielles humaines : « Qui ou que suis-je » « Qu’est ce qui agit ? » « Qu’est ce qui pense ? » « Qu’est ce qui perçoit ? » « Qu’est qui existe ? ».
Le présupposé, qui ne pourra être validé que par l’expérience personnelle, est issue des spéculations du Samkhya (autre Darśana complémentaire aux Yoga Sutra) sur la conception ontologique polarisée de l’être humain : une sorte de double identité, ou de double réalité de l’être humain.
Celle de « ce qui voit », nommée présence silencieuse, pure conscience, sans forme ni limite qui ne peut être vue, car c’est la source de la vision, permanente, unifiée, stable.
Celle de « ce qui est vu », appelée manifestation qui est multiple, variable et impermanente.
Ces deux entités « ce qui observe » et « ce qui est observé » coexistent dans la réalité humaine et la responsabilité de l’être humain, la seule chose qui a une importance selon le Yoga de Patanjali, se situe entre les deux, dans l’acte d’observation : que cet acte devienne conscient, lucide, juste… Une connaissance éclairée de la double réalité humaine. C’est l’issue proposé par ce Darśana à l’évidente souffrance inhérente à la nature humaine.
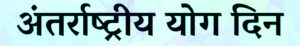
Dans cette perspective de libération de la souffrance liée à la condition humaine, une voie dite « progressive personnelle » pour tout un chacun, est proposée : l’Ashtanga Yoga de Patanjali (le Yoga pour les nuls en 8 étapes). Il existe d’autres voies dites « directes », l’extase, la grâce, ou des voies collectives des rituels et des religions, mais qui ne dépendent pas uniquement de la responsabilité individuelle, de l’expérience vécue et de l’effort personnel et conscient.
Les pratiques posturales sont le troisième membre de ce Yoga, de cette voie progressive, dont l’ambition est donc de résoudre les questionnements existentiels générés par la souffrance, et aussi de soulager cette souffrance existentielle.
Pour parvenir à cela, Patanjali propose de développer des capacités intellectuelles, des facultés sensibles et des compétences relationnelles, qu’il regroupe sous le nom de Vivēka-khyāti, un mode de perception clairvoyant et pénétrant. C’est un état d’être où il est possible de saisir dans l’expérience, ce qui est perçut, vécu, la réalité objective, et en même temps la réalité subjective, ce qui vit l’expérience, avec toutes ses composantes, avec les activité somato-psychiques mises en jeu.
Le Yoga aux huit membres de Patanjali est un protocole, une méthode qui promet d’accéder à un état de sensibilité et de lucidité où l’on comprend ce qu’on vit, tout en se comprenant soi-même. On saisit à la fois ce qui est vécu, la réalité telle qu’elle se présente, et ce qui vit cette expérience, avec tout ce que cela implique : les pensées, les émotions, les réactions du mental.
Chacun des membres de ce Yoga participent à ce projet. Ils se complètent et se nourrissent, comme un grand organisme. Ils portent tous le même élan vers/de cette clarté.
Et c’est à partir de cette perspective que commence le premier membre du Yoga Ashtanga de Patanjali : les Yama.
YAMA : ce qui retient, ce qui freine, ce qui discipline, ce qui fixe une mesure.
 Yama est aussi le nom d’une divinité, le seigneur de la mort, le gardien du passage et du discernement ultime. Il est celui qui fixe la mesure de la vie, celui qui régule le cycle, en lien avec la loi cosmique (ṛta).
Yama est aussi le nom d’une divinité, le seigneur de la mort, le gardien du passage et du discernement ultime. Il est celui qui fixe la mesure de la vie, celui qui régule le cycle, en lien avec la loi cosmique (ṛta).
Yama, est le premier des Immortels à avoir voulu connaître la finitude. Il a donc fait l’expérience de la mort (tout en restant immortel, selon la rumeur) afin de reconnaître le chemin qu’empruntent les morts humains, ainsi guidés par lui, pour parvenir à ce lieu au-delà de la mort. Yama, portant en lui le principe de la mort, est « le préposé à la condition humaine ». Il a le pouvoir de mettre la vie en dépôt chez l’homme et nécessairement la leur réclamera, un jour.
Il a une sœur jumelle Yami qui porte le désir inconditionnel de vie.
Ainsi, Yama est lié aux notions de limite, de juste mesure, de retenue qui maintiennent l’ordre du vivant.
En gardant donc à l’esprit le projet général (Viveka-Khyati) dans lequel sont inclus les Yama et le sens de mesure en fonction de références qui se veulent universelles, nous pouvons préciser un peu ces Yama :
1) Une rapide étymologie :
Ahimsā : A- privatif, exprimant la négation et -Himsā qui contient l’idée de rupture ou d’atteinte à l’intégrité (ce qui divise ou blesse). Qui ne blesse ni ne divise.
Satya : As- être exister et -tya : qui a la nature de. Qui a la nature de l’Etre donc véridique, réel, authentique.
Asteya : A- privatif, exprimant la négation et -Steya, acte d’usurper, d’ôter quelque chose à autrui, de prendre, de s’emparer, de voler. Qui ne vole, ni usurpe, ni s’empare indument.
Brahmacarya : Brahma- nom du principe absolu qui est Neti Neti et -carya se comporter, aller se mouvoir. Qui demeure, se meut dans Brahman.
Aparigraha : A- privatif, exprimant la négation, Pari- : autour, complètement, de toutes part et –grah saisir, prendre, retenir. parigraha : accumulation, possession. Qui est libre de tout mouvement d’attachement, de fixation ou de rétention.
Ces Yama sont présentés comme universels, valables quels que soient le lieu, le temps, les circonstances et le statut social. (sutra II 31).
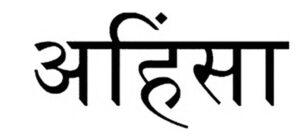
2) La polysémie du sanskrit et la forme ultra simplifiée des sutra permet différentes dimensions possibles de compréhension, d’application.
Les Yama peuvent être lues comme :
- Une morale ou une éthique, des règles de conduites sociales :
Ahimsā : une éthique de relation : veiller à ce qu’aucun acte, parole ou pensée ne provoque de souffrance. Ne blesse pas, ne détruis pas, ne divise pas. Aimer, respecter, protéger la vie dans toutes ses formes.
Satya : une cohérence éthique : dire ce qui est, sans travestir ni manipuler. La parole est alignée avec les faits et les actes.
Asteya : intégrité relationnelle : reconnaître les limites, ne pas usurper. Respect de la propriété, de la parole donnée, du domaine d’autrui.
Brahmacarya : discipline éthique : orienter sa force vers la cohérence, non vers la dispersion. Maîtrise de soi, tempérance, chasteté.
Aparigraha : sobriété : ne pas s’encombrer, faire preuve de sobriété, de simplicité. Ne pas accumuler, ne pas s’attacher aux possessions.
- Une méthode de régulation des états intérieurs, un cadre thérapeutique, un chemin de connaissance de soi. Des prescriptions de « développement personnel » :
Ahimsā : Agir sans violence
le respect de la vie : bienveillance envers tout ce qui vit, dans l’acte, la parole et la pensée. Ne pas se laisser envahir par les pulsions agressives, la réactivité, la peur.
Satya : Formuler avec clarté
le respect de la vérité : authenticité dans l’expression, transparence du regard, fidélité à l’essentiel. Exprimer simplement ce qui est, sans détour ni jugement, ni peur du jugement.
Asteya : Respecter ce qui appartient à l’autre
le respect de ce qui est juste pour toutes et tous : intégrité dans la relation, gratitude pour ce qui est donné, contenir ses élans d’avidité, de convoitise, de domination. Laisser à chacun sa part.
Brahmacarya : Discerner entre désir et besoin
le respect de la mesure : clarté dans le désir, régulation de ses pulsions. Orienter l’élan vital vers la clarté, agir dans la mesure pour apaiser et unifier.
Aparigraha : Choisir la détente
le respect du détachement : simplicité du cœur, liberté dans le lien, avoir confiance dans le mouvement de la vie. Alléger le cœur et la vie et rester libre dans le lien.
- Des principes philosophiques, avec une invitation à la réflexion, l’observation et la méditation sur la nature de ces notions (et tout ce qu’elles impliquent pour soi, en soi et en relation au monde) dans une démarche intellectuelle qui structure par des concepts, des principes la condition humaine.:
Ahimsā : L’attention à la nuisance, à la violence et à la non-nuisance, non-violence.
Satya : L’attention aux illusions, à la réalité.
Asteya : L’attention à l’appropriation, à l’offrande.
Brahmacarya : L’attention aux désirs, à la sagesse.
Aparigraha : L’attention aux attachements, aux détachements.
3) Chacun des Yama dans les Yoga Sutra est précisé par son objectif ou résultat escompté.
Quand Ahimsā s’enracine, toute hostilité alentour s’éteint d’elle-même.
Quand Satya est établie, il y a corrélation entre la parole, les actes et leurs conséquences.
Quand Asteya est établie, toutes sortes de richesses se présentent d’elles-mêmes.
Quand Brahmacarya est établi, accroissement de la puissance et de la vigueur.
Quand Aparigraha devient stable, la connaissance des origines et des cycles de la vie se révèle.

4) Les sutra étant de nature organique, il est aussi possible d’appliquer ou d’accorder les Yama à la pratique posturale, l’Asana.
Ahimsā : ne pas traiter le corps comme un instrument, respecter les limites, le rythme, écouter les résistances, respecter la physiologie. Prendre conscience de l’intégrité et la continuité dans et entre les sphères physiques, psychologiques… Réguler son rapport à l’engagement et la détente, volonté et écoute. La posture peut nous enseigner que la racine de la violence est la fragmentation, à développer la bienveillance et la délicatesse.
Satya : ne pas tricher avec son état, ni surévaluer, ou sous évaluer ses capacités. Être attentif à la vérité des déséquilibres, des tensions, des émotions. La posture peut nous enseigner à percevoir ce qui est, sans jugement, sans projection, au-delà des représentations. La pratique peut être une opportunité de se sentir, de se découvrir, de se montrer tel que l’on est, à développer la congruence et l’honnêteté.
Asteya : ne pas prendre une posture : ni le corps, ni la posture ne sont un territoire à conquérir, s’offrir à la posture ou vivre la posture comme une offrande, une célébration de la vie. Aller vers l’économie juste de l’effort, sans gaspillage, sans crispation parasite. Les schémas habituels d’appropriation, de domination, pourront être mis en évidence dans son rapport à la posture. La pratique peut être une opportunité de développer la disponibilité et le désintéressement.
Brahmacarya : aller vers la sobriété du geste, l’écoute et le respect de la subtilité du corps vivant. Chaque mouvement peut être conscient, mesuré, relié. Envisager la possibilité de pratiquer en relation à plus grand que soi, de se mouvoir dans le flux cosmique. La pratique des Asana peut mettre en évidence la gestion de l’effort, la créativité. La pratique peut être une opportunité de développer la vitalité et la sagesse.
Aparigraha : ne pas s’attacher au résultat, à la forme, à la performance. Dans la pratique de l’Asana il est possible de repérer les attentes, le besoin de contrôler, un état d’esprit utilitariste. Cultiver la détente dans l’Asana, laisser la posture se déployer et se défaire naturellement, peut offrir la possibilité d’accepter l’impermanence, de développer la retenue et le détachement.