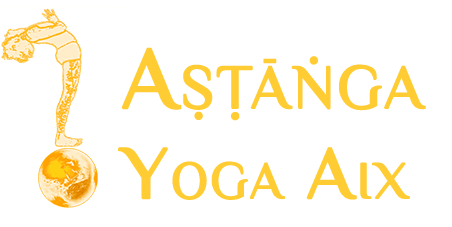Article publié par Citta Vritti
Theo Wildcroft est professeure de yoga, formatrice et chercheuse.
 Elle a publié un livre en 2020 fondé sur son travail de thèse, Post-lineage yoga, from guru to #metoo (éditions Equinox Publishing).
Elle a publié un livre en 2020 fondé sur son travail de thèse, Post-lineage yoga, from guru to #metoo (éditions Equinox Publishing).
Dans son livre, elle décrit et analyse la manière dont le yoga est transmis dans des espaces en dehors des lignées traditionnelles reconnues (par exemple Iyengar, Sivananda, Anusara…). En tant qu’anthropologue, son terrain s’est focalisé sur certains festivals alternatifs au Royaume-Uni, dans lesquels le yoga est enseigné. Son analyse soulève pour autant des questions qui trouveront un écho chez bon nombre de professeur.e.s de yoga contemporain. Elle invite à réfléchir aux dynamiques de pouvoir au sein des espaces de yoga et interroge les notions de légitimité, de sources d’autorité, et d’authenticité. Pour cela, elle se penche notamment sur un sujet crucial encore trop souvent négligé dans l’enseignement du yoga, celui des modalités de sa transmission et des pédagogies mises en œuvre pour partager la discipline.
Citta Vritti | Bonjour Theo. Pourriez-vous vous présenter et nous dire ce qui vous a conduit à travailler sur le yoga contemporain ?
Theo Wildcroft | Mon parcours tant académique que dans le yoga est un peu inhabituel. Je pratique le yoga depuis l’université, mais pendant longtemps cela n’a pas été ma pratique principale. J’ai néanmoins réalisé que j’y revenais toujours. J’ai suivi une formation à l’enseignement du yoga il y a une vingtaine d’années, dans l’école Anusara, qui était alors à son apogée. À l’époque, il y avait beaucoup de liberté dans le monde du yoga, beaucoup de plaisir et d’exploration, mais il n’y avait pas beaucoup d’analyse critique de ce que nous faisions.
J’ai enseigné le yoga quelques années dans des centres socioculturels, puis, deux choses se sont produites : l’école dans laquelle j’ai été formée a traversé une crise, et nous avons commencé à réaliser que le monde du yoga n’était pas aussi beau qu’il y paraissait. (en 2012, John Friend, fondateur de l’Anusara Yoga, a notamment été accusé de divers abus de la part de ses employé.e.s et d’avoir abusé de son statut pour multiplier les relations sexuelles avec des professeures et pratiquantes, NdlR). Par ailleurs, étant hypermobile, j’ai réalisé que ma pratique me fatiguait énormément, j’ai fait un burn-out. Je me suis alors tournée vers d’autres pratiques telles que la méditation, la relaxation, le mouvement… Cette diversité de pratiques m’a amenée à me questionner sur ma légitimité à enseigner le yoga, puisque désormais je ne tirais plus mon savoir uniquement de mon professeur de yoga, qui lui-même le tenait de son professeur, etc. A cette période, j’enseignais le yoga, la relaxation et la méditation à des enfants en situation de handicap et à des personnes très vulnérables. Enseigner à ces publics m’a amenée à me questionner sur ce qu’était le yoga et sur ses limites. Est-ce que ce que je leur enseignais était réellement du yoga ? Et si oui, est-ce que cela leur était réellement bénéfique ? Ces cours étaient un espace d’expérimentation, où j’apprenais à enseigner avec et pour les personnes présentes.
D’un point de vue académique, j’ai étudié les langues (y compris le français !) et dix ans plus tard, alors que je travaillais comme éducatrice spécialisée, j’ai suivi un Master en « Youth Work Community Education » (correspond en France à un Master en sciences de l’éducation axé sur l’éducation populaire, NdlR). Et encore dix ans plus tard, alors que j’enseignais le yoga lors d’un petit festival alternatif, j’ai eu une énième conversation avec un ami universitaire sur pourquoi personne ne parlait ni étudiait la façon dont le yoga était transmis dans ce type d’espace. J’avais l’impression que la plupart des recherches sur le yoga contemporain portaient soit sur la façon dont le yoga était pratiqué en Inde, soit, en Occident, sur le yoga “mainstream”, pour montrer à quel point il était commercial et superficiel. Mais il me semblait qu’il se passait autre chose dans ces espaces alternatifs, où les gens sont profondément engagés dans leur pratique, qui d’ailleurs n’est pas uniquement posturale, mais aussi par exemple dévotionnelle. J’ai alors décidé de faire une thèse sur la manière dont le yoga était abordé et transmis dans ces espaces.
Citta Vritti |Selon vous, pourquoi la manière dont nous enseignons le yoga mérite-t-elle d’être étudiée ?
Theo W: Quand les sources d’autorité sur lesquelles on se fondait pour appuyer notre enseignement sont remises en question et qu’on traverse une crise de légitimité, on peut choisir d’arrêter d’enseigner et de pratiquer, ce qui est un choix tout à fait entendable.
Mais si on choisit de continuer à enseigner, il est intéressant de se demander pourquoi nous continuons et ce que nous mettons en place pour que cela continue à avoir un sens. Paradoxalement, nous parlons peu de la manière dont le yoga a été et est actuellement enseigné, alors qu’il y a eu de nombreux changements dans ses modalités de transmission depuis le yoga prémoderne.
En tant qu’éducatrice spécialisée et à travers mon Master en éducation populaire, j’ai beaucoup étudié les pédagogies alternatives, lu Paulo Freire, bell hooks et d’autres universitaires du Sud Global. Il m’a fallu du temps pour connecter ces deux mondes et appliquer ces pédagogies alternatives à l’enseignement du yoga. Dans les espaces que j’ai étudiés pendant ma thèse, j’ai observé comment les gens développent des modèles pédagogiques informels, en dehors des structures traditionnelles de l’autorité yogique.
J’aime utiliser des métaphores organiques et dans le yoga, la métaphore la plus répandue pour décrire la discipline est celle de l’arbre. Mais ce que j’ai observé était plutôt un modèle rhizomatique, horizontal, basé sur la collaboration, un système souterrain et robuste. Alors que l’arbre est en fait un système très hiérarchique, assez fragile et qu’il a besoin des rhizomes pour prospérer.
Citta Vritti : Et pour poursuivre la métaphore, les lignées de yoga sont sans doute très visibles, très hiérarchisées et organisées, mais en réalité, bon nombre de pratiquant.e.s et des enseignant.e.s opèrent de façon rhizomatique. Ce mode de fonctionnement est sans doute moins visible, mais probablement plus répandu…
Theo W : Oui, et il y a une histoire riche et inconnue du yoga moderne en dehors des principales lignées.
Prenez par exemple Angela Farmer. Elle et son mari étaient des étudiants de B.K.S Iyengar, jusqu’à ce qu’il blesse gravement son partenaire. Elle s’est détournée de B.K.S. Iyengar, elle a inventé le tapis de yoga sous sa forme actuelle et elle enseigne toujours aujourd’hui. Je pense que les lignées de yoga sont effectivement les plus visibles mais qu’elles ne représentent pas la façon principale dont le yoga est partagé aujourd’hui. La plupart des enseignant.e.s ne se basent pas sur une seule source d’autorité mais sur de nombreuses sources, diverses. Et c’est d’ailleurs pour cela qu’il est très important en tant que professeur.e de toujours préciser ses sources, de dire d’où on parle, ce qu’on emprunte aux autres.
Citta Vritti : Pouvez-vous définir ce qu’est le yoga post-lignée ?
Theo W : Je pourrais d’abord dire ce que le yoga post-lignée n’est pas !
Ce n’est pas un style de yoga, ce n’est pas un yoga anti-lignée ou en dehors de toute lignée. Certaines personnes peuvent être anti-lignée dans le yoga post-lignée, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Le yoga post-lignée ne se réfère pas à une période historique (comme, par exemple, le « yoga postural moderne ») même le yoga post-lignée” a significativement gagné en visibilité ces quinze dernières années et que désormais des personnes s’en revendiquent.
Le yoga post-lignée porte sur la manière dont les savoirs sur le yoga sont partagés. Il décrit le moment où les professeur.e.s de yoga vont au-delà d’une source unique pour légitimer leur autorité à enseigner. C’est, par exemple, un professeur de yoga Iyengar qui prend conscience qu’il y a eu des avancées scientifiques depuis Light on Yoga de Iyengar (B.K.S Iyengar, 1964) et qui va lire des articles scientifiques sur la biomécanique pour éclairer son enseignement.
Mais le yoga post-lignée, ce n’est pas non plus « tout est permis ! », que tout le monde peut faire ce qu’il veut avec la pratique. Les enseignant.e.s se fondent sur des sources d’autorité, de légitimité, clairement identifiables. Elles sont simplement négociées de manière informelle là où précédemment elles étaient sanctionnées par une hiérarchie.
Citta Vritti : Justement, comment les notions telles que « l’autorité », « l’authenticité » ou « la légitimité » sont-elles articulées dans le yoga post-lignée ?
Theo W : J’ai remarqué que dans ces espaces, les pratiquant.e.s et enseignant.e.s reconnaissaient et articulaient trois sources d’autorité.
D’abord, l’expertise externe, (que ce soit B.K.S. Iyengar, un article sur la biomécanique, etc.) dont il faut soupeser la validité. Ensuite, l’expérience personnelle, subjective : c’est le fait d’expérimenter des choses sur votre tapis ou avec vos élèves. Par exemple, essayer de pratiquer une méthode décrite dans un ancien texte de yoga et voir quels effets cela provoque sur vous, sur les autres. La dernière source d’autorité, ce sont nos pairs. Lorsque vous faites partie d’une communauté d’enseignant.e.s, vous faites en permanence le point sur vos savoirs auprès de vos pairs, implicitement ou explicitement. Ces sources d’autorité nécessitent certaines conditions pour être valables.
Pour que votre expérience personnelle soit robuste, vous devez avoir la possibilité d’expérimenter, d’explorer.
Pour faire le tri dans les sources d’expertise externes, il est nécessaire de cultiver un esprit critique solide. Pour que votre réseau de pairs fonctionne efficacement comme source d’autorité, il doit être relativement diversifié. Si toutes les personnes avec lesquelles vous parlez de yoga sont blanches, viennent de Paris, ou sont des hommes, vous aurez sans doute des biais.
Citta Vritti : Vous dites que le yoga post-lignée n’est pas lié à une période historique, pourtant le sous-titre de votre livre, « From guru to #metoo », suggère une évolution historique. Selon vous, quels ont été les principaux moteurs ayant conduit à l’émergence d’un yoga “post-lignée”?
Theo W : Il est difficile de comparer avec la façon dont le yoga était transmis à l’époque prémoderne car il est difficile d’établir une base de référence commune. Mais selon les spécialistes du yoga prémoderne, le yoga post-lignée, dans le sens d’un croisement de diverses sources d’autorité pour la pratique et la transmission du yoga, a probablement aussi été la manière principale de partager le yoga dans le passé. Et aujourd’hui encore en Inde, bien que les yogis se réclament d’une lignée spécifique et d’un guru particulier, en s’intéressant de plus près à leurs pratiques concrètes, on se rend compte que ce n’est pas si simple. Ils sont en réalité en contact avec d’autres sadhus, ils suivent parfois plus d’un guru, sont même influencés par le yoga moderne…
Concernant le yoga post-lignée, on peut attribuer son émergence aux diverses crises d’autorité et de légitimité qu’a connu ces vingt dernières années le monde du yoga.
D’abord une crise historique, avec notamment le livre de Mark Singleton qui a déclenché de nombreuses crises de foi quant à l’authenticité de nos pratiques de yoga postural contemporaines (Aux origines du yoga postural moderne, éditions Almora, 2020, qui montre que le yoga majoritairement pratiqué aujourd’hui en Occident est le fruit récent d’une hybridation de pratiques issues du hatha yoga indien et de gymnastiques européennes, dans un contexte colonial, NdlR). Il y a également eu une crise scientifique, montrant que les bienfaits prêtés au yoga n’étaient pas toujours vrais ou prouvés.
 Et puis bien sûr, les scandales d’abus et de crimes, entre autres sexuels, qui concernent toutes les lignées du yoga moderne. La multiplicité des cas d’abus prouve que le problème se situe à un niveau structurel et non individuel. C’est à dire que le problème ne vient pas de tel ou tel gourou qui serait une mauvaise personne, mais que structurellement, ces abus ont été rendus possibles. À l’époque prémoderne, les gurus avaient une audience plutôt restreinte. Mais des figures comme Satyananda, Sivananda, J. Friend ont fini à la tête de multinationales, avec des centaines d’emplois à la clé, des milliers d’enseignants de yoga qui dépendent d’eux… C’est beaucoup de pouvoir concentré entre les mains d’une seule personne, le tout alimenté par le mythe qui veut qu’un gourou de yoga est intrinsèquement bienveillant. Les abus ont probablement toujours existé, mais cette néolibéralisation du yoga a augmenté la portée et l’impact des abus.
Et puis bien sûr, les scandales d’abus et de crimes, entre autres sexuels, qui concernent toutes les lignées du yoga moderne. La multiplicité des cas d’abus prouve que le problème se situe à un niveau structurel et non individuel. C’est à dire que le problème ne vient pas de tel ou tel gourou qui serait une mauvaise personne, mais que structurellement, ces abus ont été rendus possibles. À l’époque prémoderne, les gurus avaient une audience plutôt restreinte. Mais des figures comme Satyananda, Sivananda, J. Friend ont fini à la tête de multinationales, avec des centaines d’emplois à la clé, des milliers d’enseignants de yoga qui dépendent d’eux… C’est beaucoup de pouvoir concentré entre les mains d’une seule personne, le tout alimenté par le mythe qui veut qu’un gourou de yoga est intrinsèquement bienveillant. Les abus ont probablement toujours existé, mais cette néolibéralisation du yoga a augmenté la portée et l’impact des abus.
La journaliste Katie Poole a écrit en 2012 que l’affaire John Friend signait « la fin de l’ère des sages sur le devant de la scène”, des “gourous-stars” (“the end of the age of the gurus on the stage”, NdlR). Elle était un peu en avance sur son temps ! Mais ces différentes crises sont aussi un signe que le monde du yoga évolue, grandit.
Citta Vritti : Quels conseils donneriez-vous aux professeurs de yoga qui veulent créer des espaces plus accueillants, sans dynamiques de pouvoir oppressives ?
Theo W : C’est une question à laquelle je préfère répondre de manière contextualisée et spécifique, car chaque communauté a ses propres enjeux. Une partie de mon travail aujourd’hui consiste à animer des ateliers auprès de communautés de yoga existantes, comme je l’ai fait à Paris chez Satya Yoga, pour les aider à trouver des réponses adaptées à leur contexte, leurs enjeux, l’existant. Je ne donne pas de solutions mais je viens avec mes idées, mes modèles, et nous travaillons ensemble sur les stratégies à mettre en œuvre, qui valorisent ce qui fonctionne déjà et qui explorent des nouvelles façons de faire.
Mais je peux partager avec vous quelques principes simples :
Votre enseignement doit être aussi peu coûteux que possible : pour vous en tant que professeur, mais aussi pour vos élèves. Au lieu de vous tourner vers “ce qui brille”, ce qui vous coûtera sans doute cher en termes d’argent, de marketing, investissez des espaces locaux, des centres socioculturels, qui ne coûtent presque rien et qui accueillent des publics intéressants. Rendez votre enseignement le plus durable possible pour vous en tant que professeur.e mais aussi pour vos élèves. Durable financièrement, mais aussi en termes d’énergie investie et de création de liens, de communautés.
Cultivez vos réseaux de pairs, vos communautés de professeur.e.s sont importantes !
Déconstruisez votre perception de ce que doit être un.e professeur.e de yoga : cessez de prétendre être le “sage sur le devant de la scène”. Il y a des choses très simples à faire pour sortir de cette posture, comme par exemple enseigner en cercle. Il s’agit d’adopter une posture de facilitatrice / facilitateur, d’éducatrice / éducateur, plutôt que d’instructrice / instructeur. Nous avons trop longtemps emprunté au modèle d’instruction hérité des salles de sports, souvent dérivé du modèle militaire, très vertical, où nous ordonnons aux gens quoi faire plutôt que de les autonomiser.
Il y a de nombreuses définitions du yoga, alors je demande souvent aux futur.e.s professeur.e.s de yoga : quel est le yoga que vous voulez enseigner ? Et par là, je ne veux pas dire le « hatha yoga » ou « yoga de la relaxation » mais plutôt, par exemple : j’enseigne le yoga des relations : les relations avec vous-même, avec les autres. J’enseigne aussi le yoga de l’agentivité : un yoga qui redonne aux gens leur pouvoir d’action, de faire des choix par eux-mêmes.
Une fois que vous avez déterminé ce que vous souhaitez transmettre, tout peut devenir un outil pour atteindre cet objectif.
Citta Vritti : Une question que se posent beaucoup de professeur.e.s de yoga contemporain, notamment occidentales et occidentaux, est de savoir dans quelle mesure il est possible d’innover sans pour autant nuire à l’esprit du yoga. Que pensez-vous ?
Theo W : Je retournerais cette question et je dirais : le fait que les professeur.e.s de yoga soient obsédé.e.s par cette question est une bonne chose. Cela signifie que nous nous tenons mutuellement redevables de ce que nous faisons. Nous devons continuer à nous poser cette question, car cela signifie que nous remettons en question ce que nous faisons. C’est un équilibre à trouver et un équilibre est par nature dynamique.
Citta Vritti : Vous êtes sur le point de publier un nouveau livre coécrit avec Harriet McAtee intitulé The Yoga Teacher’s Survival Guide. Social Justice, Science, Politics, and Power (éditions Singing Dragon, à paraître en avril 2024). A quoi les professeur.e.s de yoga doivent-iels survivre ? Quels sont les principaux défis auxquels iels sont confronté.e.s ?
Theo W : Il a été difficile de trouver un bon titre pour ce livre ! Nous voulions qu’il soit utile aux professeur.e.s de yoga lorsqu’iels rencontrent ces fameuses crises de foi, de légitimité. L’ouvrage est donc construit autour de ces questions : l’argent et le pouvoir, les questions de race et de justice sociale, l’esprit critique, l’intégration de la question des traumas, l’application de l’approche scientifique à la discipline…
Le livre n’est pas là pour convaincre de continuer à pratiquer le yoga ou au contraire de l’abandonner, il donne des outils afin de prendre une décision éclairée . Par ailleurs, ce livre est le résultat d’un travail collectif : Harriet et moi avons demandé à de nombreux autres auteurices d’écrire ce livre avec nous car justement nous avons besoin d’une diversité de points de vue pour réfléchir aux crises que traverse le yoga contemporain. La production de savoirs ne se fait jamais seul.e.